Cinq ans après Mafia: Definitive Edition, Hangar 13 remonte le fleuve de sa propre mythologie avec Mafia: The Old Country, disponible depuis le 8 août 2025 sur Xbox Series. Plus de Lost Heaven, plus de prohibition, plus de cabriolets américains : cette fois, c’est la Sicile des années 1920 qui sert de berceau à l’histoire, terrain brut, aride, encore rural, où les règles du silence précèdent celles du pouvoir. Vous incarnez Marco Leoni, exilé de retour sur la terre de ses ancêtres, happé par les dettes familiales et les alliances empoisonnées d’un village tenu à l’ombre des premières familles mafieuses. Le jeu abandonne l’illusion de l’open world au profit d’une structure plus resserrée, presque théâtrale, où chaque quartier devient un décor, chaque contact un choix, chaque mission un risque à calculer.
Hangar 13 renoue avec la grammaire du premier Mafia, mais en la durcissant : gunfights plus rigides, infiltration plus tendue, rythme volontairement lent, cadrages serrés. Le moteur affiche une Sicile crue, silencieuse, rugueuse — une terre de poussière, de pierre et de dette. Les dialogues, majoritairement en italien sous-titré, ancrent l’action dans un réalisme linguistique rarement vu dans une production de ce calibre. Mais cette austérité formelle, assumée, peut-elle encore convaincre en 2025 ? Dans un paysage vidéoludique où la mise en scène spectaculaire est devenue norme, The Old Country peut-il imposer sa lenteur, son ancrage historique et sa violence contenue comme autant de vertus plutôt que d’obstacles ?
Le minerai, la dette et le serment d’un carusu
 L’histoire s’ouvre sous terre. Littéralement. Dans les galeries suffocantes d’une mine de soufre sicilienne, vers 1923, Enzo Favara, enfant d’aucune lignée, carusu sans avenir, extrait la matière du sol avec ses ongles. Le décor n’est pas une métaphore : il est une sentence. Le monde ne vous doit rien, et vous non plus. Lorsque l’accident survient — explosion, éboulement, disparition d’un ami — le jeu ne cherche ni l’héroïsme ni l’émotion immédiate. Il choisit la coulée lente, l’étouffement. Enzo remonte, brisé, et c’est là qu’il rencontre le Don — Bernardo Torrisi, patriarche d’un empire qui ne dit pas encore son nom. La dette s’échange contre une promesse : vous ne serez plus pauvre. Mais vous ne serez plus libre non plus. C’est à cette croisée que The Old Country pose ses enjeux. Il ne s’agit pas de monter dans la mafia : il s’agit d’y survivre sans devenir ce que vous redoutez.
L’histoire s’ouvre sous terre. Littéralement. Dans les galeries suffocantes d’une mine de soufre sicilienne, vers 1923, Enzo Favara, enfant d’aucune lignée, carusu sans avenir, extrait la matière du sol avec ses ongles. Le décor n’est pas une métaphore : il est une sentence. Le monde ne vous doit rien, et vous non plus. Lorsque l’accident survient — explosion, éboulement, disparition d’un ami — le jeu ne cherche ni l’héroïsme ni l’émotion immédiate. Il choisit la coulée lente, l’étouffement. Enzo remonte, brisé, et c’est là qu’il rencontre le Don — Bernardo Torrisi, patriarche d’un empire qui ne dit pas encore son nom. La dette s’échange contre une promesse : vous ne serez plus pauvre. Mais vous ne serez plus libre non plus. C’est à cette croisée que The Old Country pose ses enjeux. Il ne s’agit pas de monter dans la mafia : il s’agit d’y survivre sans devenir ce que vous redoutez.
La narration refuse l’escalade. Pas de glamour, pas de rituel stylisé. Chaque mission vous enferme un peu plus dans le réseau familial. Vous gérez un petit domaine, vous négociez avec un contremaître, vous éteignez un conflit qui couvait déjà depuis une génération. Le récit ne vous offre pas de virage net, mais une progression insidieuse. Chaque nom croisé revient plus tard, chaque affrontement laisse une trace. La construction suit une logique quasi-littéraire : actes, scènes, ellipses, retours. Le temps passe, mais l’étau se resserre. Le jeu vous fait vieillir sans jamais vous laisser vieillir en paix. Là où d’autres mafias célébraient la montée au pouvoir, The Old Country dissèque la compromission continue.
Les personnages ne sont pas des archétypes : ils sont des outils de pression. Luca Trapani, bras droit du Don, homme d’armes et d’ordre, agit moins comme un guide que comme un mur. Il n’apprend rien, il vérifie si vous tenez. Cesare Massaro, neveu nerveux, vous entraîne dans des conflits qu’il ne comprend pas, et vous laisse en gérer les conséquences. Isabella Torrisi, fille unique, tente de tenir l’équilibre moral de la famille, mais le poids des hommes l’efface trop souvent. Tino, consigliere taciturne, est partout et nulle part, témoin des tensions que personne n’assume. Le jeu ne cherche pas à rendre ses personnages aimables. Il cherche à les faire peser. Chacun d’eux est un choix en suspens, une complicité involontaire, une trahison qu’on ne formule pas.
 Cette densité, cette retenue permanente, produit un effet paradoxal. Le jeu est écrit avec sobriété, parfois avec éclat, mais il frustre aussi. Certains arcs s’interrompent brutalement. Certaines scènes — notamment celles qui impliquent les membres extérieurs à la famille Torrisi — manquent d’amplitude. On perçoit des tensions politiques, religieuses, sociales, mais elles restent à l’état de décor. L’intime écrase le collectif. C’est un parti pris. Mais c’est aussi une limite. Là où Mafia I évoquait une époque, The Old Country reste focalisé sur un huis clos mafieux, dont la puissance dramatique se heurte parfois à son manque d’oxygène.
Cette densité, cette retenue permanente, produit un effet paradoxal. Le jeu est écrit avec sobriété, parfois avec éclat, mais il frustre aussi. Certains arcs s’interrompent brutalement. Certaines scènes — notamment celles qui impliquent les membres extérieurs à la famille Torrisi — manquent d’amplitude. On perçoit des tensions politiques, religieuses, sociales, mais elles restent à l’état de décor. L’intime écrase le collectif. C’est un parti pris. Mais c’est aussi une limite. Là où Mafia I évoquait une époque, The Old Country reste focalisé sur un huis clos mafieux, dont la puissance dramatique se heurte parfois à son manque d’oxygène.
Reste une cohérence d’ensemble impressionnante. L’italien est omniprésent, les sous-titres sobres, la mise en scène sèche et géométrique. Les silences ne sont pas là pour faire joli — ils sont des armes. Le scénario n’ose jamais le spectaculaire. Il préfère la fissure lente, le mot qui manque, le regard qui trahit. On ne sort pas grandi de cette histoire. On en sort usé, lesté. Le jeu ne vous transforme pas en Don : il vous montre ce qu’il en coûte d’en approcher un. Et dans cette lente immersion, dans ce refus de tout spectaculaire, il touche une forme de vérité. Rugueuse, opaque, impitoyable.
Lenteur tendue, cadence imposée, impact mesuré
 Mafia: The Old Country assume un gameplay qui rompt frontalement avec les standards actuels du jeu d’action narratif. Ici, pas de sprint permanent, pas de mécanique de parkour, pas de surcouche ludique pour flatter l’agilité du joueur. Le corps d’Enzo pèse, ralentit, fatigue. Chaque déplacement est pensé pour restituer une présence physique dans le monde. L’animation ne cherche pas la souplesse, elle cherche la crédibilité : sauter un muret demande un élan, ramasser une arme une intention, se mettre à couvert une urgence. Le jeu refuse l’agilité surnaturelle, et c’est dans cette contrainte que se forge sa tension.
Mafia: The Old Country assume un gameplay qui rompt frontalement avec les standards actuels du jeu d’action narratif. Ici, pas de sprint permanent, pas de mécanique de parkour, pas de surcouche ludique pour flatter l’agilité du joueur. Le corps d’Enzo pèse, ralentit, fatigue. Chaque déplacement est pensé pour restituer une présence physique dans le monde. L’animation ne cherche pas la souplesse, elle cherche la crédibilité : sauter un muret demande un élan, ramasser une arme une intention, se mettre à couvert une urgence. Le jeu refuse l’agilité surnaturelle, et c’est dans cette contrainte que se forge sa tension.
Les gunfights, rares mais décisifs, héritent du système de couverture de Mafia III mais le resserrent autour d’un arsenal réduit, de mouvements lourds, d’un recul marqué. Les armes, rudimentaires, bruyantes, lentes à recharger, renforcent la dimension réaliste des affrontements. Pas de headshots automatiques, pas de killcams héroïques. Tuer ici n’est ni valorisé ni spectaculaire : c’est une rupture dans la mécanique narrative, un bruit sec dans le rythme du jeu, une conséquence plus qu’un objectif. Et c’est là que réside la singularité du système : le combat n’est jamais un climax. Il est le symptôme d’un échec.
 Les missions alternent entre infiltration discrète, négociations tendues, filatures, protection de convois, livraisons à risque ou interventions ciblées. Le rythme est volontairement lent. Le level design cloisonne l’action dans des quartiers semi-ouverts, chacun relié par un hub central qui évolue selon vos actes. La ville, morcelée, n’est pas un open world mais un décor narratif dense. Il n’y a pas de collecte, pas de mini-jeux, pas de missions annexes gratuites. Tout sert l’intrigue principale. Ce choix structurel — abandonner la distraction pour l’intention — renforce la tension mais limite aussi la variété des approches. Le jeu vous propose une ligne claire, mais peu de chemins secondaires.
Les missions alternent entre infiltration discrète, négociations tendues, filatures, protection de convois, livraisons à risque ou interventions ciblées. Le rythme est volontairement lent. Le level design cloisonne l’action dans des quartiers semi-ouverts, chacun relié par un hub central qui évolue selon vos actes. La ville, morcelée, n’est pas un open world mais un décor narratif dense. Il n’y a pas de collecte, pas de mini-jeux, pas de missions annexes gratuites. Tout sert l’intrigue principale. Ce choix structurel — abandonner la distraction pour l’intention — renforce la tension mais limite aussi la variété des approches. Le jeu vous propose une ligne claire, mais peu de chemins secondaires.
Certains systèmes secondaires auraient mérité plus de profondeur. La gestion de la réputation entre familles, par exemple, ne dépasse pas l’indicateur implicite. Il y a bien des conséquences à vos choix, des dialogues alternatifs, des fins différentes, mais elles ne passent pas par une mécanique formalisée. Le joueur ressent la tension, mais ne la maîtrise jamais totalement. C’est un parti pris narratif, mais aussi une frustration potentielle pour ceux qui attendent un jeu à embranchements visibles. De la même manière, l’infiltration reste rudimentaire dans sa gestion : cônes de vision larges, IA peu réactive, options de diversion limitées.
Mais là encore, c’est la cohérence de l’ensemble qui l’emporte. The Old Country n’essaie pas de faire plaisir : il essaie de faire tenir un monde. En restreignant ses systèmes, en durcissant ses mécaniques, en ralentissant son tempo, le jeu vous impose une manière de jouer. Une façon de vous mouvoir, de réagir, de décider. Cela produit un effet rare : vous ne jouez pas comme vous voulez, vous jouez comme vous devez. Et dans cet encadrement brutal, parfois rigide, se dessine une forme d’élégance ludique, presque oubliée dans les productions modernes.
Poussière de chaux, silences d’église et lumière de plomb
 Mafia: The Old Country n’embrasse pas la Sicile comme une carte postale. Il la recrée comme un relief hostile, pierreux, minéral, où la beauté ne se livre jamais sans contrainte. L’architecture des villages mêle ruelles étroites, façades décrépies, intérieurs trop sombres. Les collines n’invitent pas à l’exploration : elles vous rappellent ce que c’est que de monter avec des bottes boueuses et un manteau trop lourd. La direction artistique refuse la saturation. Pas de ciels azurés. Pas de couchers de soleil stylisés. Le jeu préfère les fins d’après-midi brumeuses, les lumières rasantes, les intérieurs éclairés à la bougie ou au poêle. Même la mer paraît lointaine, presque inaccessible.
Mafia: The Old Country n’embrasse pas la Sicile comme une carte postale. Il la recrée comme un relief hostile, pierreux, minéral, où la beauté ne se livre jamais sans contrainte. L’architecture des villages mêle ruelles étroites, façades décrépies, intérieurs trop sombres. Les collines n’invitent pas à l’exploration : elles vous rappellent ce que c’est que de monter avec des bottes boueuses et un manteau trop lourd. La direction artistique refuse la saturation. Pas de ciels azurés. Pas de couchers de soleil stylisés. Le jeu préfère les fins d’après-midi brumeuses, les lumières rasantes, les intérieurs éclairés à la bougie ou au poêle. Même la mer paraît lointaine, presque inaccessible.
Techniquement, le moteur graphique réutilise certains fondements de Mafia: Definitive Edition, mais les affine : textures plus précises, gestion dynamique des ombres revue, expressions faciales plus détaillées. Les personnages principaux profitent d’un soin évident dans l’animation, notamment au niveau des micro-expressions — froncement de sourcils, crispation de mâchoire, hésitation du regard. En revanche, les PNJ secondaires souffrent d’un traitement plus standardisé. Les mouvements restent rigides dans les scènes de foule, les animations contextuelles peinent parfois à s’aligner, et les collisions ne sont pas toujours maîtrisées, notamment en intérieur. Mais ces limites techniques n’entachent pas l’atmosphère. Elles laissent place à l’essentiel : l’impression de réalité.
 Le sound design participe activement à cette construction. Les bruits de pas sur les pavés, les portes grinçantes, les sabots sur la terre, les coups de fusil lointains étouffés par les collines : tout ici sonne juste. Le mixage audio refuse la compression : les scènes calmes sont presque trop silencieuses, obligeant à écouter, à capter les inflexions, à faire attention à ce qui n’est pas dit. La musique, rare, intervient par nappes orchestrales graves, des motifs de cordes discrets, parfois inspirés de mélodies liturgiques siciliennes. Aucun thème ne cherche à s’imposer — ils passent comme des courants d’air dans les églises ouvertes.
Le sound design participe activement à cette construction. Les bruits de pas sur les pavés, les portes grinçantes, les sabots sur la terre, les coups de fusil lointains étouffés par les collines : tout ici sonne juste. Le mixage audio refuse la compression : les scènes calmes sont presque trop silencieuses, obligeant à écouter, à capter les inflexions, à faire attention à ce qui n’est pas dit. La musique, rare, intervient par nappes orchestrales graves, des motifs de cordes discrets, parfois inspirés de mélodies liturgiques siciliennes. Aucun thème ne cherche à s’imposer — ils passent comme des courants d’air dans les églises ouvertes.
Le doublage suit cette retenue. L’essentiel des dialogues est en italien sous-titré, avec quelques glissements vers l’anglais lors de scènes impliquant des étrangers ou des figures administratives. Ce choix linguistique renforce l’ancrage et transforme chaque échange en acte de présence. Les voix, jamais surjouées, portent l’émotion dans la respiration, l’hésitation, l’économie. Pas de joutes verbales, pas de punchlines. Juste des conversations qui pèsent, parce qu’elles précèdent toujours un acte. Ce dépouillement sonore — volontaire, cohérent, exigeant — isole le jeu dans une forme de réalisme rarement vue dans le médium. Et c’est précisément cette retenue, ce refus de flatter l’oreille ou l’œil, qui donne au monde sa densité.



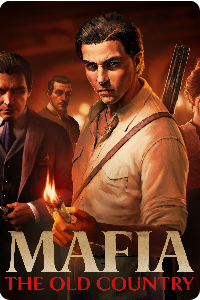

0 commentaires