Développé par Retrofiction Games, Dead of Darkness est sorti sur Nintendo Switch le 2 juillet 2025, convoquant une esthétique résolument rétro pour replonger dans les racines du survival-horror. Caméras fixes, pixel art crasseux, bruitages suffocants : tout ici évoque un monde figé dans une lente agonie. Mais derrière cette façade d’hommage, le titre parvient-il à tisser une angoisse propre, ou se contente-t-il de disséquer ses influences sans jamais y insuffler de vie ?
Des silhouettes perdues dans un théâtre de cendres
 Dead of Darkness vous enferme dans une petite ville côtière rongée par une malédiction sourde. Vous incarnez un enquêteur envoyé pour élucider une série de disparitions, mais rapidement pris au piège d’un cauchemar où le réel se déforme et où chaque porte cache une menace. L’écriture, volontairement minimaliste, distille ses informations à travers des notes, des dialogues courts et des visions hallucinées. Le monde ne raconte pas directement. Il chuchote, il suggère, il laisse des vides à combler.
Dead of Darkness vous enferme dans une petite ville côtière rongée par une malédiction sourde. Vous incarnez un enquêteur envoyé pour élucider une série de disparitions, mais rapidement pris au piège d’un cauchemar où le réel se déforme et où chaque porte cache une menace. L’écriture, volontairement minimaliste, distille ses informations à travers des notes, des dialogues courts et des visions hallucinées. Le monde ne raconte pas directement. Il chuchote, il suggère, il laisse des vides à combler.
Les personnages croisés sur votre route ne sont pas des compagnons de voyage. Ce sont des ombres, des résidus d’humanité. Une infirmière murée dans un mutisme traumatisé. Un prêtre dont la foi vacille face à la monstruosité. Un enfant qui répète des phrases sans cohérence. Aucun ne vous guide. Tous semblent perdus dans leur propre boucle. Leur présence ajoute au malaise plus qu’elle ne rassure.
Le protagoniste lui-même reste une figure floue. Son passé se dévoile par bribes, à travers des flashbacks et des hallucinations qui questionnent la véracité des événements. Cette opacité nourrit un sentiment d’isolement qui pèse de plus en plus à mesure que les couloirs se rétrécissent et que la ville s’efface sous la brume.
Ce choix narratif, entre silence et fragments cryptiques, ancre Dead of Darkness dans une tradition héritée de Silent Hill. Mais il frôle parfois la caricature : certains dialogues trop sibyllins et des révélations téléphonées trahissent la gravité qu’ils cherchent à imposer. La peur naît moins de la dramaturgie que de l’ambiance étouffante qui la porte.
Une mécanique grinçante dans un écrin rigide
 Le système de jeu de Dead of Darkness assume un classicisme presque dogmatique. Le joueur évolue dans une ville labyrinthique où chaque porte peut cacher une clé, une énigme ou un monstre tapi dans l’ombre. Les caméras fixes, volontairement contraignantes, transforment le moindre virage en pari. L’espace est calculé pour générer de l’angoisse, non de l’efficacité. Ici, la peur naît de ce qu’on ne voit pas.
Le système de jeu de Dead of Darkness assume un classicisme presque dogmatique. Le joueur évolue dans une ville labyrinthique où chaque porte peut cacher une clé, une énigme ou un monstre tapi dans l’ombre. Les caméras fixes, volontairement contraignantes, transforment le moindre virage en pari. L’espace est calculé pour générer de l’angoisse, non de l’efficacité. Ici, la peur naît de ce qu’on ne voit pas.
Les affrontements, rares et maladroits, renforcent cette tension. Le personnage se manie avec lourdeur : chaque coup de feu exige un temps d’arrêt, chaque esquive une anticipation presque inhumaine. Les armes, peu nombreuses, imposent une gestion stricte des munitions. Le moindre gaspillage condamne. Les combats sont moins des séquences de bravoure que des épreuves à traverser dans un état de vulnérabilité permanente.
Le level design exploite cette fragilité. Les zones se déploient comme un réseau de couloirs et de pièces interconnectées, où l’on revient sans cesse pour résoudre des énigmes ou activer des mécanismes. Ces puzzles, parfois inspirés, parfois artificiels, rompent le rythme et imposent des moments de réflexion. Ils rappellent que la survie n’est pas seulement une affaire de force, mais d’observation et de mémoire.
Mais ce carcan rigide, qui impose la lenteur et la méthode, risque aussi de fatiguer. Les allers-retours incessants, la difficulté d’orientation et l’absence de carte intuitive alourdissent inutilement la progression. Ce qui devrait être une tension devient par moments une frustration.
Un pixel art saturé par l’ombre et le silence
 Visuellement, Dead of Darkness adopte un pixel art dense, presque étouffant. Les textures granuleuses et les palettes sombres évoquent l’esthétique des survival-horror des années 90, mais la composition des plans et le travail d’éclairage portent une maîtrise moderne. Les caméras fixes transforment chaque environnement en tableau : angles obliques, couloirs étroits, lumières vacillantes qui déchirent à peine les ténèbres. Cette mise en scène fige le joueur dans une tension permanente.
Visuellement, Dead of Darkness adopte un pixel art dense, presque étouffant. Les textures granuleuses et les palettes sombres évoquent l’esthétique des survival-horror des années 90, mais la composition des plans et le travail d’éclairage portent une maîtrise moderne. Les caméras fixes transforment chaque environnement en tableau : angles obliques, couloirs étroits, lumières vacillantes qui déchirent à peine les ténèbres. Cette mise en scène fige le joueur dans une tension permanente.
Les animations, minimalistes, servent ce malaise. Les mouvements du protagoniste, lents et saccadés, rappellent une vulnérabilité constante. Les ennemis, silhouettes difformes à la démarche imprévisible, amplifient la peur de l’inconnu. Chaque apparition est un moment suspendu, non par la violence graphique, mais par l’attente qu’elle installe.
La bande-son est un autre pilier de cette atmosphère. Les musiques, rares, laissent souvent place à un silence pesant, troué par des grincements, des pas, des respirations étouffées. Quand elles surgissent, ce sont des nappes dissonantes, des accords brisés qui enveloppent le joueur comme une brume sonore. Les bruitages, eux, frappent juste : le claquement d’une porte, le craquement d’un plancher, le cri lointain d’une créature suffisent à maintenir un état d’alerte.
Mais cette économie visuelle et sonore, qui fait la force du jeu, trahit parfois ses limites techniques. Certains décors se répètent, les sprites manquent de variété, et des effets sonores réutilisés brisent ponctuellement l’illusion d’un monde vivant. Ce sont des accrocs dans une toile qui, dans ses meilleurs moments, parvient à capturer l’essence du genre.
Un socle stable rongé par une inertie volontaire
 Sur Nintendo Switch, Dead of Darkness tourne sans accroc. Le framerate, fixé à 60 fps, ne faiblit jamais, même dans les environnements les plus chargés en effets de lumière ou lors des transitions entre pièces. Les temps de chargement sont quasi inexistants, et aucun bug critique ne vient entraver l’expérience. La console portable absorbe sans peine l’esthétique rétro du titre et restitue son ambiance oppressante avec fidélité.
Sur Nintendo Switch, Dead of Darkness tourne sans accroc. Le framerate, fixé à 60 fps, ne faiblit jamais, même dans les environnements les plus chargés en effets de lumière ou lors des transitions entre pièces. Les temps de chargement sont quasi inexistants, et aucun bug critique ne vient entraver l’expérience. La console portable absorbe sans peine l’esthétique rétro du titre et restitue son ambiance oppressante avec fidélité.
L’ergonomie, en revanche, trahit la fidélité excessive aux codes du survival-horror des années 90. L’inventaire, limité, exige des allers-retours incessants entre les coffres de stockage. La sélection des objets, peu intuitive, ralentit chaque action. Le joueur doit composer avec une lourdeur qui participe certes à la tension, mais qui peut aussi devenir une contrainte artificielle.
La durée de vie avoisine les huit à dix heures pour une première partie, selon la capacité du joueur à résoudre les énigmes. Mais cette estimation varie fortement en fonction du temps perdu à explorer et à comprendre la logique des puzzles. L’absence d’options de confort modernes – carte dynamique, aide contextuelle – force une immersion complète mais risque de décourager les moins patients.
Enfin, aucun mode additionnel ou contenu secondaire ne prolonge l’expérience après la fin de l’aventure. Le titre se veut une capsule, une parenthèse angoissante sans ambition de rejouabilité autre que la recherche de fins alternatives.

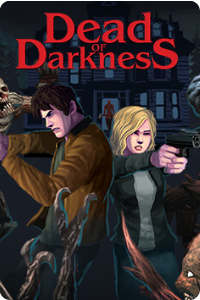

0 commentaires