Bunker 22, développé par Garden of Dreams, s’est glissé sur Nintendo Switch le 1 mai 2025 comme un cri étouffé dans le béton. FPS narratif à petit budget, il vous enferme dans un monde post-pandémique, sans horizon, sans échappatoire, sans illusion.
Vous êtes un généticien réveillé dans une cabane. Le monde ? Effondré. Les hommes ? Morts ou mutés. Seul objectif : atteindre le bunker numéro 22, dernier vestige d’un programme d’extinction qui se prenait pour une chance de survie. Pas de soldat. Pas de héros. Juste un scientifique trop tardif, trop seul, trop humain.
Mais derrière ses couloirs délavés et ses zombies standardisés, Bunker 22 a-t-il la moindre chose à dire ? Ou n’est-il qu’une tentative low-cost d’agiter des monstres dans un couloir sans lumière ?
Des fantômes pour mémoire, des chiffres pour testament
 L’histoire de Bunker 22 ne cherche pas à convaincre. Elle impose une situation : le monde a chuté, les expériences ont échoué, et vous vous réveillez trop tard. Aucune cinématique d’exposition, aucun tutoriel bavard. Seulement une maison isolée, une note griffonnée, et la certitude que la suite ne sera qu’une lente descente.
L’histoire de Bunker 22 ne cherche pas à convaincre. Elle impose une situation : le monde a chuté, les expériences ont échoué, et vous vous réveillez trop tard. Aucune cinématique d’exposition, aucun tutoriel bavard. Seulement une maison isolée, une note griffonnée, et la certitude que la suite ne sera qu’une lente descente.
Le protagoniste est un généticien — silhouette sans nom, sans visage, sans voix. Il n’existe que par ses actions et les fragments de documents qu’il découvre : rapports d’expériences, journaux audio, restes de correspondances internes. Ces éléments composent une narration disséminée, déchiquetée, où chaque révélation ne répare rien, n’explique rien. Elle enfonce.
 Le cœur narratif repose sur le bunker lui-même. Divisé en sections verrouillées, il n’abrite pas des réponses, mais des ruines administratives. Chaque salle raconte une partie de l’effondrement : des tests ratés, des cobayes évaporés, des scientifiques disparus. Le récit ne s’écrit pas. Il se lit sur les murs. Les corps parlent, les machines mentent, les mots s’effacent.
Le cœur narratif repose sur le bunker lui-même. Divisé en sections verrouillées, il n’abrite pas des réponses, mais des ruines administratives. Chaque salle raconte une partie de l’effondrement : des tests ratés, des cobayes évaporés, des scientifiques disparus. Le récit ne s’écrit pas. Il se lit sur les murs. Les corps parlent, les machines mentent, les mots s’effacent.
Il n’y a pas de personnages secondaires vivants. Seulement des voix mortes, des noms oubliés, des IA détraquées. Le joueur reste seul. Seul à assembler un puzzle dont les pièces manquent. Seul à constater que le bunker n’a jamais été une solution — seulement un cercueil étanche, bien ordonné.
Bunker 22 refuse le confort du récit linéaire. Il ne raconte pas une rédemption. Il dresse un constat : l’humain a perdu, il ne reste que des portes à ouvrir, et des erreurs à traverser.
Verrouillés dans le tunnel, armés pour rien
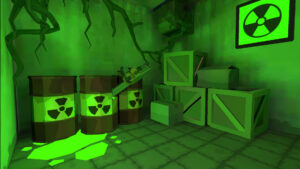 Bunker 22 veut être un jeu de tir. Il se présente comme tel. Arme en main, interface minimale, munitions comptées. Et pourtant, il ne tient jamais sa promesse. Le tir n’est pas un exutoire, c’est un artifice. Une mécanique approximative greffée sur une structure qui ne sait pas quoi en faire.
Bunker 22 veut être un jeu de tir. Il se présente comme tel. Arme en main, interface minimale, munitions comptées. Et pourtant, il ne tient jamais sa promesse. Le tir n’est pas un exutoire, c’est un artifice. Une mécanique approximative greffée sur une structure qui ne sait pas quoi en faire.
La visée est lente, rigide, parfois imprécise. Les armes manquent de feedback, les impacts n’existent pas. Tirer, ici, n’est qu’un acte de gestion : économiser les balles, trouver les bons angles, compenser les hitboxes hasardeuses. Aucun plaisir. Aucun rythme. Juste une lenteur pesante, comme si chaque séquence de tir était une concession, pas un choix de design.
 Le level design est à l’image du monde : stérile. Couloirs gris, pièces vides, portes à codes. L’exploration se limite à tourner en rond entre deux panneaux d’accès et une salle de contrôle. Pas d’espace à habiter, pas de verticalité à dompter. Juste des salles, des interrupteurs, des objets à ramasser. L’agencement ne suit aucune logique organique : tout semble placé pour ralentir, pas pour intriguer.
Le level design est à l’image du monde : stérile. Couloirs gris, pièces vides, portes à codes. L’exploration se limite à tourner en rond entre deux panneaux d’accès et une salle de contrôle. Pas d’espace à habiter, pas de verticalité à dompter. Juste des salles, des interrupteurs, des objets à ramasser. L’agencement ne suit aucune logique organique : tout semble placé pour ralentir, pas pour intriguer.
Quelques énigmes tentent de casser la monotonie, mais tombent à plat : codes à quatre chiffres, combinaisons d’interrupteurs, lectures de rapports absurdes pour deviner un mot de passe. Rien n’est difficile, mais tout est inutile. Le jeu ne vous teste pas. Il vous freine.
 La boucle de gameplay repose sur un enchaînement binaire : avancer, tuer, débloquer, avancer. Aucun système secondaire ne vient perturber cette routine. Pas de gestion de santé élaborée. Pas d’inventaire. Pas de craft. Pas même de progression réelle. Ce que vous avez au départ est ce que vous aurez à la fin. Le jeu ne construit rien. Il ne fait que refermer les portes derrière vous.
La boucle de gameplay repose sur un enchaînement binaire : avancer, tuer, débloquer, avancer. Aucun système secondaire ne vient perturber cette routine. Pas de gestion de santé élaborée. Pas d’inventaire. Pas de craft. Pas même de progression réelle. Ce que vous avez au départ est ce que vous aurez à la fin. Le jeu ne construit rien. Il ne fait que refermer les portes derrière vous.
Mais c’est peut-être là le paradoxe de Bunker 22. Ce qu’il propose est insuffisant. Mais ce qu’il empêche est pire. À force de ne rien oser, il devient inoffensif. Et dans un monde censé être au bord du gouffre, c’est l’erreur fatale : on ne ressent ni peur, ni urgence, ni impact.
Des murs gris pour un monde sans cri
 Visuellement, Bunker 22 est une régression. Non pas dans le style — il n’en a pas — mais dans la texture même de son monde. Tout y est plat, monochrome, indistinct. Le jeu affiche des couloirs gris, des terminaux ternes, des lumières fades. Le bunker n’est pas un lieu. C’est une suite d’angles morts. Rien ne vit. Rien ne marque. Tout est interchangeable.
Visuellement, Bunker 22 est une régression. Non pas dans le style — il n’en a pas — mais dans la texture même de son monde. Tout y est plat, monochrome, indistinct. Le jeu affiche des couloirs gris, des terminaux ternes, des lumières fades. Le bunker n’est pas un lieu. C’est une suite d’angles morts. Rien ne vit. Rien ne marque. Tout est interchangeable.
Les modèles 3D — zombies, armes, objets — semblent issus d’une bibliothèque générique. Les ennemis se ressemblent tous : silhouettes lentes, animations sommaires, textures floues. Ils apparaissent, avancent, encaissent, tombent. Aucun effort d’animation, aucune mise en scène. Pas même un effet de décomposition. À l’heure où même les petits studios travaillent la dissonance ou l’organique, Bunker 22 reste figé dans l’ère des moteurs amateurs.
Les éclairages sont rigides, sans dynamique. Pas de lumière volumétrique, pas d’ombres projetées en temps réel, pas d’ambiance. Certains couloirs affichent un brouillard artificiel, comme posé par dessus l’écran. On devine l’intention d’immersion, mais la réalisation l’écrase. Le décor ne respire pas. Il stagne.
Côté son, même constat. Une boucle musicale discrète se répète jusqu’à l’usure, avec quelques variations à peine audibles selon les zones. Le sound design, lui, est quasi inexistant : les armes claquent sans impact, les ennemis gémissent comme des fichiers WAV mal compressés, et les sons d’environnement (portes, alarmes, ventilation) sont réutilisés à l’excès. Rien ne surprend. Rien ne dérange. Le bunker est sourd.
 Il n’y a pas de doublage. Les quelques journaux audio sont lus par une voix synthétique générique, sans timbre, sans intention. Pas de détresse. Pas de colère. Juste une diction robotique, probablement générée à la chaîne. Le récit en souffre. L’ambiance s’effondre.
Il n’y a pas de doublage. Les quelques journaux audio sont lus par une voix synthétique générique, sans timbre, sans intention. Pas de détresse. Pas de colère. Juste une diction robotique, probablement générée à la chaîne. Le récit en souffre. L’ambiance s’effondre.
Bunker 22 est un monde visuellement amputé. Il ne construit aucune imagerie. Il ne propose aucun motif. Et dans un genre qui repose sur l’atmosphère et l’étouffement, c’est une faute cardinale.
Rien à configurer, rien à découvrir, rien à revenir chercher
 Techniquement, Bunker 22 fonctionne. Mais il fonctionne au minimum vital. Sur Nintendo Switch, le jeu tourne en 30 fps, sans chute flagrante, mais avec une latence constante dans les interactions. Ouvrir un menu, activer un interrupteur, viser une arme : tout semble traverser une couche de gélatine. Ce n’est pas une catastrophe. C’est une fatigue.
Techniquement, Bunker 22 fonctionne. Mais il fonctionne au minimum vital. Sur Nintendo Switch, le jeu tourne en 30 fps, sans chute flagrante, mais avec une latence constante dans les interactions. Ouvrir un menu, activer un interrupteur, viser une arme : tout semble traverser une couche de gélatine. Ce n’est pas une catastrophe. C’est une fatigue.
Les temps de chargement sont longs, sans justification apparente. Aucun open world, aucun streaming de données lourdes : juste des salles, des zombies, et des portes. Et pourtant, chaque transition entre zones impose son écran noir, son attente, sa respiration forcée. Le rythme en prend un coup, et avec lui, l’immersion.
Pas de multijoueur. Pas de contenu additionnel. Pas de New Game+. Aucune forme de rejouabilité. Le jeu se termine en deux à trois heures, sans embranchement, sans secret, sans trace. Ce n’est pas une expérience à explorer. C’est un couloir à subir. Et une fois franchi, il ne vous reste qu’un vide fonctionnel — ni souvenir, ni envie de retour.




0 commentaires