Sept années ont passé. Sept longues années depuis Salt and Sanctuary, ce coup de tonnerre indépendant qui avait su, avec une audace déconcertante, transposer la brutalité méthodique d’un Souls dans un écrin 2D métalleux et suffocant. Rarement une telle justesse d’intention, de contrôle et d’univers n’avait été atteinte dans le genre. Et pourtant, aucune annonce, aucun teaser, aucun frémissement n’avait laissé présager l’arrivée d’une suite.
Et puis Salt and Sacrifice est arrivé. Sans fracas. Sans fanfare. Presque à pas de loup.
Le studio Ska, fidèle à son artisanat rugueux, revient avec une ambition démesurée : celle de surpasser son propre mythe, d’élargir son monde, de densifier sa mécanique, d’injecter une formule de chasse à la Monster Hunter dans la matrice Soulslike. Sur le papier : la promesse d’une évolution. En pratique : un précipice.
Car à vouloir tout amplifier, Salt and Sacrifice perd ce qui faisait sa force initiale. L’élégance de la contrainte, le poids de chaque coup, la lecture précise du danger. Ce n’est pas une trahison — c’est pire : un projet déformé par la pression, alourdi par ses propres ambitions, sacrifiant la cohérence sur l’autel de la complexité.
Inquisiteur sans cause, mages sans mystère
Le récit de Salt and Sacrifice s’ouvre sur une condamnation : celle de votre protagoniste, criminel anonyme promis à l’exécution. Une seule échappatoire s’offre à lui — rejoindre les rangs des Inquisiteurs, cette caste sacrifiée, chargée de traquer les Mages corrompus dans les terres ravagées de l’Altère Royaume. Une entrée en matière brutale, presque biblique, à la hauteur de la noirceur de son univers.
Mais que reste-t-il de l’ambition narrative du premier opus ? L’ésotérisme poétique de Salt and Sanctuary, sa manière d’évoquer plus qu’il ne montre, a laissé place à une structure plus bavarde, plus peuplée, mais aussi plus déséquilibrée. Si la localisation française est cette fois d’excellente tenue, et que les nombreux PNJ disséminés dans les zones enrichissent le lore avec soin, l’ensemble manque de tension dramatique. On écoute plus qu’on ne ressent. On collecte les bribes d’un monde brisé, sans que jamais l’urgence du récit ne vienne vraiment frapper.
Le nouveau concept central, la « chasse aux mages », aurait pu dynamiser la progression narrative. Il n’en est rien. Chaque traque s’intègre de façon mécanique, déconnectée de toute évolution émotionnelle. Les mages ne sont pas des antagonistes charismatiques, mais des sacs à loot désincarnés. Aucun ne porte une identité marquante. Aucun ne devient figure de mémoire. Ce ne sont pas des boss, ce sont des ressources sur pattes.
Et si l’écriture globale reste solide, avec un effort visible de densification de l’univers, elle s’étiole dès qu’il s’agit de construire un véritable fil rouge. Les motivations de votre avatar restent floues, la symbolique s’efface derrière la répétition des rituels, et la mise en scène reste d’une austérité frustrante, privant les moments clés de leur portée.
Enfin, le dernier affront : la conclusion précipitée, qui expédie le joueur en New Game+ sans préambule, sans choix, sans répit. Une sortie de route brutale, qui réduit à néant ce que le jeu parvenait encore à maintenir debout : le sentiment d’incarner un destin, même minuscule, dans un monde condamné.
Chasser l’ennui, capturer la frustration
Dans Salt and Sacrifice, tout converge vers une seule mécanique : la traque des Mages, présentée comme l’évolution centrale du système hérité de Salt and Sanctuary. Concrètement, le joueur sélectionne une cible, remonte ses traces à travers une carte infestée, la combat une première fois, puis recommence — jusqu’à forcer le duel final dans son antre. Une boucle qui aurait pu générer tension, anticipation, montée en puissance. Elle n’offre que répétition, dispersion et essoufflement.
Contrairement à un Monster Hunter, dont le modèle est ici ouvertement pillé, Salt and Sacrifice s’inscrit dans une logique Soulslike : perte d’expérience à chaque mort, ennemis revanchards, apprentissage par l’échec. Et c’est là que le jeu se fissure. Car appliquer un système de chasse à une philosophie de punition permanente revient à créer une friction destructrice. L’effort n’est pas récompensé : il est rincé, recyclé, piétiné par une IA erratique et un loot aléatoire.
Le farming devient obligatoire. Certains matériaux rares, nécessaires à l’artisanat d’équipements essentiels, n’apparaissent qu’après plusieurs victoires répétées contre le même boss, dans un système aux règles opaques. L’idée d’optimisation s’efface derrière la corvée. Et si l’on ose parler d’exploration, il faut préciser : Salt and Sacrifice n’explore pas, il rentabilise. Chaque détour mène à un affrontement redondant, chaque victoire à une nouvelle mouture du même rituel.
Côté combat, le titre reproduit la base du premier opus : sauts, esquives, attaques légères et lourdes, gestion de l’endurance. Mais une anomalie fondamentale vient briser la cohérence du tout : les attaques aériennes suspendent littéralement votre personnage dans les airs. Plus de gravité. Plus d’élan. Vous frappez, vous flottez. Une absurdité physique qui détruit toute fluidité, et transforme les affrontements en séquences rigides, contre-intuitives et souvent injouables.
À cela s’ajoute un bestiaire aux patterns chaotiques, impossible à lire ou à anticiper. Loin des chorégraphies mortelles mais lisibles d’un Souls, Salt and Sacrifice multiplie les ennemis imprévisibles, aux attaques injustes, et prive le joueur d’une phase d’apprentissage. C’est moins une montée en compétence qu’une série d’erreurs à corriger dans l’urgence.
Enfin, l’arbre de compétences, immense et inutilement touffu, illustre cette volonté d’expansion sans direction. On y navigue sans vision, ajoutant des points à la chaîne sans jamais sentir de transformation concrète dans la jouabilité. Un gonflement systémique, sans impact réel.
Esthétique sacrifiée, univers éteint
Visuellement, Salt and Sacrifice conserve l’ADN graphique de son prédécesseur : un style 2D dessiné à la main, empreint d’une noirceur gothique assumée, entre gravures maladives et éclats de chair surnaturelle. Mais là où Salt and Sanctuary imposait un univers viscéral, sale, habité par sa crasse et ses silences, cette suite perd en texture, en cohérence, en impact.
Les environnements sont vastes, labyrinthiques, articulés autour d’un level design clairement plus ambitieux. Montagnes, catacombes, forteresses et ruines magiques s’enchaînent, chacune dotée de zones secrètes, de raccourcis, de sanctuaires à débloquer. Le monde gagne en surface. Mais il y perd en personnalité. Les biomes, malgré leurs efforts de différenciation, finissent par se ressembler : même architecture désaturée, même construction horizontale, mêmes palettes sombres et ternes. Aucune n’impose de mémoire durable.
L’animation, quant à elle, trahit les limites du moteur. Le personnage semble glisser plus que marcher, certaines transitions sont raides, et la lisibilité des attaques — pourtant cruciale — est souvent brouillée par des effets visuels parasites ou des postures figées. Les combats manquent de nerf, non pas à cause de leur rythme, mais parce que leur esthétique n’offre aucun poids, aucune brutalité, aucun feedback sensoriel digne de ce nom.
Les Mages, censés incarner l’essence du surnaturel, sont un autre point d’échec. Leur design oscille entre le banal et le grotesque, sans jamais atteindre le grotesque fascinant que l’on attend d’un tel univers. Trop souvent, ces créatures-clés manquent d’aura, d’emphase, de démesure visuelle. On les abat sans jamais les craindre.
Côté sonore, le constat est plus nuancé. La bande-son s’efface, parfois à tort, mais elle sait instaurer une atmosphère mélancolique, entre nappes d’ambiance caverneuses et percussions feutrées. Les effets sonores, eux, sont inégaux : certaines armes manquent d’impact, certaines magies saturent, d’autres s’effondrent dans l’anonymat. Le mixage global souffre d’un manque de relief, rendant certaines séquences trop plates, trop distantes.
Pas de doublage. Pas de travail vocal. Et dans un monde aussi lourd de symboles et de douleur, le silence des personnages devient une absence, non une tension.
Systèmes empilés, efforts éparpillés
À l’image de son gameplay, Salt and Sacrifice multiplie les couches systémiques sans jamais les fondre dans une vision cohérente. L’impression dominante est celle d’un jeu dévoré par ses propres ambitions techniques, incapable de hiérarchiser ses idées, ni de les harmoniser.
La gestion de l’équipement repose intégralement sur l’artisanat. Chaque Mage abattu vous offre des composants uniques, servant à fabriquer armes, armures ou talismans. Mais le loot étant aléatoire et fragmenté, la logique de progression devient purement statistique : on rejoue, on farm, on espère. Il ne s’agit plus d’explorer ou d’accomplir, mais de répéter un cycle jusqu’à ce que les bonnes pièces tombent. La mécanique de gratification est artificielle.
Le système de soins repose lui aussi sur une logique absurde. Pour reconstituer vos potions, vous devez ramasser manuellement des herbes dans chaque zone. Pas d’objets persistants, pas de régénération passive. Chaque retour au combat devient un aller-retour logistique, transformant la difficulté en corvée. Un choix de design qui ne punit pas le joueur : il l’use.
Ajoutez à cela un arbre de compétences d’une démesure inutile, où chaque point distribué donne l’illusion d’un choix, mais où les spécialisations sont si vastes qu’elles diluent l’impact de chaque décision. L’absence de lisibilité, de visibilité sur les bénéfices concrets, nourrit une progression floue, sans plaisir ni stratégie.
Enfin, la structure même du jeu trahit sa direction hésitante. Les zones sont accessibles via un portail central, déverrouillé par des runes. Une bonne idée en apparence, mais qui aboutit à une navigation rigide, peu intuitive, avec de nombreux aller-retours stériles. Et lorsque le jeu vous force à recommencer la chasse à partir du hub, après chaque échec, l’épuisement supplante la tension.
Multijoueur ? Oui, mais réduit à une dimension fonctionnelle. Le PvP, les invasions, les aides en ligne existent — mais ne sont jamais mis en avant, jamais intégrés au rythme de la progression. Ce n’est pas un mode pensé pour enrichir l’expérience. C’est une option greffée.
Quant à l’accessibilité, rien n’est fait. Aucun ajustement de difficulté, aucun mode de confort, aucune alternative de progression pour ceux qui n’adhèrent pas à la logique du grind. Un parti pris cohérent avec la philosophie “hardcore”, mais ici mal équilibré, mal justifié, et souvent frustrant par sa pure rigidité.

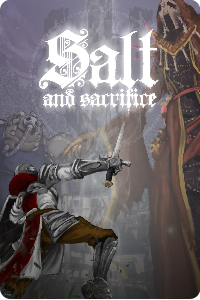

0 commentaires